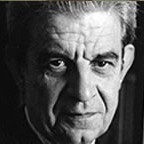[mercredi 24 mars 2010]
Celui qui vous parle de la vie de Lacan a partagé, au moins partagé pendant 16 ans, son temps de loisirs. Je ne l’ai pas connu comme analysant, je l’ai fréquenté comme un familier et puis comme un membre de sa famille. Je n’abuse pas de l’avantage que cela me donnerait et, à vrai dire, je serais bien en peine de le faire parce que Lacan n’était pas prodigue de confidences, ni de son propre mouvement, ni parce qu’il aurait invité ses proches à entrer dans la dimension du souvenir. Au contraire : il se déplaçait avec une sorte de champ de forces dont on sentait qu’il repoussait toute inquisition.
C’est même ce silence épais, maintenu, qui me conduisit à un moment à satisfaire ma curiosité sur sa trajectoire antérieure, en allant aux textes, à ce qui subsistait dans des revues, voire dans des manuscrits anciens, de son affaire avec les Sociétés analytiques. C’est ainsi que je ressortis couvert de poussière d’une investigation dans une pièce, un cagibi laissé à l’abandon au 5, rue de Lille, où s’étaient accumulés des vieux papelards en désordre et où je réussis à sauver la lettre qu’il avait écrite à son analyste, Rudolph Lowenstein, au moment de la scission de 1953 qui devait donner naissance à la Société française de psychanalyse. Je trouvai manuscrite cette lettre et puis une première version qui avait été déchirée, mais en morceaux suffisamment grands pour qu’on puisse reconstituer le texte, et je publiai tout ça en lui demandant un avant-propos où il écrivit : « Tout ce qui est publié ici me fait horreur. » Et cette horreur de parler du passé était bien ce qui tenait éloigné de le questionner.
Par deux fois, pourtant, je lui posai une question intime. Et les deux fois où je m’aventurerai ainsi, il me répondit. Ces souvenirs-là, ces deux souvenirs-là, je vais les évoquer aujourd’hui, je constate qu’ils ne m’ont jamais quitté car je ne les ai pas consignés par écrit à leur date.
Rétrospectivement, je pourrais trouver cette abstention de ma part curieuse. Mais elle allait de soi en ce temps-là. Elle est sans doute à rapporter à ma répugnance à jouer le James Boswell de Lacan, dont j’ai déjà parlé. Boswell ne laisse pas douter que s’il consignait jour après jour les dits de Samuel Johnson, et les menus incidents de sa vie, c’était pour complaire à son maître. Johnson ne demandait que ça. Il aurait été fort déçu que son intime ne jugeât point suffisamment intéressant, pour la postérité, l’événement quotidien pour ne pas le préserver. Rien n’était plus loin de Lacan. Il y avait pour lui une bipartition nette entre ce qui vaut et ce qui ne vaut pas. Et le courant de l’existence était pour lui ce qu’il fallait bien payer comme tribut pour que se forme la perle de sa pensée. Le reste était comme la coquille de l’huître qu’on jette et il ne se souciait pas le moins du monde d’être photographié. C’est le mot qui m’est venu en y pensant : photographié.
Et, à vrai dire, ce mot, photographié, si j’y fais attention, je m’aperçois qu’il me vient d’une réplique de Lacan. Celui-là, de souvenir, je vais vous le livrer tout de suite. J’avais composé pour des Journées, ou un Congrès, de l’École freudienne de Paris – c’était le nom de l’École de Lacan – un texte sur la présentation de malades que Lacan faisait tous les quinze jours à l’hôpital Sainte-Anne. J’avais composé ce texte à une époque – les années 70 – où l’exercice même de la présentation était mal vu. Nous étions dans les suites de mai 68 et il régnait au Quartier latin, chez ceux que par la suite on a appelé les bobos et où se recrutait une part importante de ce personnel qui peuplait le milieu analytique – il régnait une atmosphère où un tel exercice de maîtrise passait pour attentatoire aux droits de l’homme. Il faut bien dire que cet exercice de la présentation de malades, qui avait été traditionnel, était déjà depuis plus d’une décennie – et sans doute son déclin avait-il commencé dès après la Deuxième guerre mondiale -, tombé en désuétude. On était donc dressé contre la démonstration de maîtrise que comporte une présentation et on supposait en plus qu’elle était nocive au patient. Or Lacan y restait attaché et avait continué, invariablement, à y procéder devant un public qui rassemblait – au moment où moi-même j’y participais -, une cinquantaine de ses élèves. Et, exprimant le désaveu ambiant, il s’était exprimé dans un article une certaine Maud Mannoni qui devait à l’époque mettre sur pied une institution de soins pour enfants et qui elle-même regroupait un certain nombre de suivants. Elle s’était exprimée contre, et moi j’étais pour. J’étais pour puisque dans cette présentation, j’y trouvais moi-même l’occasion de faire mes classes, mes classes de clinique alors que ma formation initiale avait été dans les Lettres et plus spécialement dans la Philosophie. Et il me paraissait tout à fait déplacé, injuste, à côté de la plaque, de réduire cette présentation à une exhibition de bêtes curieuses. Je ne voyais pour ma part aucune réification – transformation en chose -, du patient, et j’avais donc voulu apporter un témoignage contraire et à contre-courant de la sensibilité du milieu. J’avais voulu décrire la façon de faire de Lacan et, ce faisant, tirer des enseignements clinique du style de l’interrogatoire auquel Lacan procédait et aussi des quelques propos qu’il lâchait à la fin, une fois que le patient s’était retiré. C’était régulièrement des propos assez critiques et allusifs. De telle sorte que quand je pris l’habitude de me réunir avec quelques personnes de ma génération en alternance avec cette présentation pour la commenter, en petit groupe, peut-être en cartel, je me souviens qu’on s’interrogeait autant sur Lacan que sur le patient.
Parmi ces enseignements que moi j’avais tiré de ses énigmatiques proférations, il y avait par exemple la différence dont il me semblait utiliser les ressources, entre ce que j’appelais maladie de l’Autre – avec un grand A – et maladie de la mentalité – les maladies de la mentalité que j’appelais ainsi en référence aux indications que Lacan donnaient alors, fugitives, dans son Séminaire sur ce qu’il appelait ainsi la mentalité, ça me semblait faire écho. C’est ce que plus tard, bien plus tard, que j’ai épinglé du nom, qui a fait florès et on doit supposer que c’est en raison d’une certaine adaptation au terrain, le mot de « psychose ordinaire ». C’est quand, si l’on veut, la psychose ne prend pas forme et où c’est justement cet informe qui la dénonce. J’avais prononcé cet exposé, préalablement écrit, à la tribune du congrès.
À la fin de la matinée me voilà à courir pour rattraper Lacan dans la rue Saint-Dominique, le congrès étant dans ce bâtiment qui existe toujours de la Maison de la Chimie, et ce pour lui tenir un petit discours que je croyais urgent. En effet, il avait pris la parole à un moment de cette matinée, et il avait prit ses distances et même implicitement moqué un de nos collègues de cette École. Et moi, je voulais le lui signaler. Quoi ? Lui dire que ce n’était pas très gentil de sa part, et lui demander de rectifier, au moins de tempérer son propos, en somme lui demander quelques bonnes paroles pour ce collègue que j’imaginais froissé. Et en effet, en ce temps-là, il suffisait d’un mot de Lacan, un mot de travers pour que tout se mette à trembler, que le monde se mette à trembler sur ses bases, le petit monde, que ce petit milieu se mette à trembler sur ses bases et que la personne ainsi pointée ait le cœur chaviré. Et apparemment je prenais ça sur moi, je jouais une sorte de Monsieur Bons Offices. Il marchait, je marchais avec lui, à ses côtés, il m’écouta, s’arrêta, me considéra, avec cette attitude de côté, le regard invisible, une certaine lenteur qui marquait qu’il n’allait pas attraper l’hameçon qu’on lui tendait, que ça, c’était mon affaire, pas la sienne, et il me dit exactement ceci : « Vous m’avez parfaitement photographié à ma présentation. » Et il reprit sa marche, tandis que je demeurais avec ça.
Alors, d’abord, c’était une fin de non-recevoir, c’était une façon de dire «j’ai dit ce que j’ai dit ». Il le disait d’autant mieux qu’il ne le disait pas. L’arrêt, la réplique lente, avait valeur de balayer ma remontrance. Donc, de produire un déplaisir, mais ce déplaisir que j’avais à éprouver, logiquement se trouvait anticipé et éteint par un compliment. Ce qui me laissait entre deux – est-ce du lard ou du cochon ? C’était en quelque sorte me dire : vous venez de me dire n’importe quoi, mêlez-vous de ce qui vous regarde – d’une part, et de l’autre, c’était me féliciter à propos de quelque chose où je n’attendais rien de lui.
Lacan n’était pas prodigue de compliments, et en plus je dois dire je n’avais pas confiance dans ses compliments. Je l’avais vu faire à la chaîne des dédicaces pour un ouvrage de lui qui était paru, l’écrit Télévision que les Éditions du Seuil avaient publié comme une mince plaquette, à mon initiative, et j’avais assisté Lacan rédigeant une vingtaine, une trentaine de petites dédicaces, chacune fort bien tournée, dont il était patent qu’elles visaient à chatouiller la vanité de ses dédicataires. Et donc, dans cette attitude moi même distanciée que je maintenais, quand il m’adressa ce compliment, j’en gardai plutôt un « il ne m’écoute pas ». Mais le souvenir est resté, le souvenir de cet incident tout à fait mineur. Et il reste qu’il avait entendu de ce que j’avais dit « qu’il était photographié », et parfaitement. Or à vrai dire ce qui pour moi comptait, ce n’était pas du tout de l’avoir photographié lui, c’était d’avoir mis en forme ses enseignements, les enseignements de sa présentation. C’est ça que j’avais visé, voilà ce que ça nous apprend. Et cette fois-là, au fond, Lacan avait déplacé l’accent de son enseignement sur, tout de même, sa personne. Et, si je m’en souviens à cette occasion aujourd’hui, c’est que ce mouvement je le reproduis sans doute aujourd’hui où, après une vie passée à communiquer, formaliser, simplifier, ces enseignements, je donne quelque attention à la vie de Lacan. Et ça m’est occasion de m’apercevoir, qu’en fait, je ne l’ai jamais photographié Lacan, sauf une fois.
Il ne reste qu’une photo dont il n’y a plus le négatif et qui, la dernière fois que je l’ai vue, aperçue, il y a une dizaine d’années, montraient des couleurs passées, bientôt il n’en restera rien. C’était dans la circonstance suivante, alors qu’il montait l’escalier de pierre qui conduisait à une pièce de sa maison de campagne, une ancienne grange aménagée en bureau et en bibliothèque où il préparait ses Séminaires et que l’on appelait l’atelier ; alors qu’il montait cet escalier moi je sortais de cette pièce où il m’arrivait de travailler aussi, donc il montait, des papiers sous le bras, et j’avais dans les mains un appareil de photos que je destinais à tout autre chose, mais enfin là ce fut clic clac. Et donc, c’est, au hasard, la seule fois où je le photographiais, en 16 ans.
Et si je continue sur la photographie, je crois bien n’avoir jamais été photographié avec lui. Et lorsque j’en ai eu l’occasion, ou j’aurais eu l’occasion d’être filmé avec lui, pour l’émission de télévision pour laquelle il écrivit un texte, qui a été publié, je pris soin d’être invisible. Il faut croire que je me gardais d’occuper la place de faire couple avec lui. Et les faits ont l’air d’indiquer que j’avais comme le pressentiment qu’être à la place de son autre – petit autre – c’était dangereux, voire maléfique. Il y a une chose que je me suis dite, néanmoins, c’est que peut-être je me trouvais métaphoriquement à ses cotés à un endroit que personne ne soupçonnait et moi non plus, sur le moment. C’est quand j’avais choisi la couverture d’un de ses Séminaires, la couverture du Séminaire XI, le premier que je rédigeais, les Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. J’avais choisi l’illustration comme allant de soi étant donné l’enseignement du Séminaire et la place que Lacan y donnait à l’anamorphose qui figure sur cette toile. Mais il n’y a pas que l’anamorphose sur cette toile. L’anamorphose là, une tête de mort. Il y a ce qui donne le titre au tableau : les Ambassadeurs. Et au premier plan il y a en a un, grand et magnifique, et puis au second plan il y en a un second plus modeste et discret. Et des années plus tard je me dis mais voilà où tu t’es représenté toi, à côté de Lacan.
Avec le recul du temps, je me dis qu’après tout j’aurais bien pu prendre cette expression, « parfaitement photographié », comme un encouragement à faire le Boswell. Est-ce que ça n’était pas, de la part de Lacan, comme un hameçon lancé pour m’inviter, oui, à continuer. Mais il faut bien dire qu’en un certain sens Lacan ne m’intéressait pas. Lacan, la personne, pour moi, je m’en tenais à carreaux, ce qui m’intéressait c’était de transformer les impressions que j’avais pu avoir à sa présentation en enseignements. C’est ce qui m’a habité toutes ces années là, la transformation de Lacan en enseignements. Et c’est une sorte de part perdue que je récupère ces temps-ci, cette année-ci, dans ces quelques prises de paroles que je vous distribue depuis janvier, tant que j’en ai encore envie.
Alors, il n’empêche que je me suis demandé pourquoi Lacan, je me le suis demandé maintenant, pourquoi Lacan s’était-il trouvé, alors, parfaitement photographié. Dans quoi exactement s’est-il reconnu ? Et donc j’ai relu mon petit texte des enseignements de la présentation de malades, que j’ai retrouvé parce qu’il a été republié voici cinq ans, voici cinq ans mais la première édition doit être antérieure, la première édition de ce premier recueil doit être antérieure, dans un volume qui s’appelle la Conversation d’Arcachon – « Cas rares, les inclassables de la clinique » – c’est bien le cas. Et j’ai relu ce texte et je me suis aperçu, au fond, que ce que je signalais, ce que je développais, c’était la coupure entre Lacan et l’assistance de sa présentation. C’était sa posture, la posture par quoi il se décomptait de la réunion de ses élèves. Vous me permettrez là de me citer. Je mettais en valeur d’abord tel effet de surprise que le propos après présentation de Lacan pouvait produire, quand il en dégageait un diagnostic, un pronostic, que personne semble-t-il n’avait élaboré soi-même, dans son quant-à-soi.
« L’Assistance – j’en fais partie -, je dirais qu’elle est sotte par fonction, voyeurs, écouteurs, qui sont là en surnombre, apprentis, et Lacan ne nous relève pas de cette déchéance, en laissant, comme tel psychiatre, se créer cette atmosphère de complicité qui ne demande qu’à s’étendre entre le maître et les élèves pour qui il travaille, et qu’il protège en même temps du risque de l’exercice. Nulle barrière physique dans la salle et pourtant nous pourrions aussi bien être derrière une glace sans tain, ou plutôt c’est comme si une capsule transparente isolait Lacan et son malade enveloppé, supporté par une attention invariable, rendue sensible par l’immobilité presque complète du questionneur.
L’assistance est là silencieuse, mais on devine que si elle parlait, elle parlerait comme un chœur antique. Quand nous sommes cette assistance, nous figurons la doxa, l’opinion publique,la civilisation moderne, et la connivence s’établit plutôt là entre le malade et nous. Quand il évoque les ‘formules un’, nous savons, nous qu’il s’agit de voitures de compétition, tandis que Lacan ne le sait pas, lui ne comprend pas, il se fait répéter, expliquer. »
Je m’arrête là dans cette lecture mais c’est à ça que je rapporte – à la relecture – ce dont Lacan m’a donné le témoignage, son sentiment d’être parfaitement photographié là : dans ce qui n’a rien à voir avec l’assistance, qu’il se décompte du savoir de l’assistance. C’est là qu’il s’est reconnu, quand il est saisit dans sa position d’exception et d’exception par rapport à un auditoire que je modelais comme le grand Autre, comme l’Autre du sens commun, que Lacan, au début de son enseignement appelait le discours universel. Et je ne pouvais y attribuer que sottise au sens même où Lacan peut dire dans son Séminaire XX, Encore, que le signifiant est bête. Dans la présentation du malade, j’ai trouvé ça dont je donnais le compte rendu, que cet Autre du discours universel, du signifiant, est bête et en plus – c’est dans le reste de la première partie de ce texte – et qu’en plus d’être bête, cet Autre est compatissant, que ce qui retient cet Autre de l’auditoire dans la bêtise, c’est qu’il compatit au destin du patient. Autrement dit cet Autre est bon. Et là il y a comme mise en valeur dans ma photographie cette connexion de la bêtise et de la bonté.
Et là, relisant ce texte, je me trouvais tout de suite porté à ce dit de Lacan auquel j’ai fait un sort : « Tout le monde est fou», ce dit du dernier Lacan. Et je voyais bien qu’au fond cela veut dire : il n’y a pas de sens commun. Et le sens commun, c’est une catégorie qui – explicitement ou plus secrètement – traverse la philosophie. A quoi fait-elle l’appel dans son exercice, dans les opérations de pensées auxquelles elle invite, à quoi fait-elle appel d’autre qu’à la supposition du sens commun : elle spécule sur le sens qui nous serait commun. Il y a une dimension, en effet, qui est du sens commun mais qui est illusoire par rapport au niveau où l’expérience analytique vous attrape. Au niveau où l’expérience analytique vous attrape, pas question de faire appel au sens commun, et si vous le faites vous sortez de l’expérience analytique, à ce niveau-là personne n’a de sens commun, c’est un niveau où vous différez. Ce qui compte pour vous, ce qui fait sens, ce qui fait question, ce qui fait attrait, ce qui fait dégoût, ce qui fait ce qu’il vous est impossible de supporter, ce qui fait ce qui vous est aisé, agréable, tout cela qui compte pour vous ne vous donne aucune assurance sur ce qui compte pour un autre. C’est la leçon, c’est ce mathème de la différence subjective, radicale, que l’expérience d’une analyse est censée vous apporter par des voies chaque fois différentes. Lacan l’évoquait à propos d’Alice au pays des merveilles et de la figure initiale du lapin pressé qui a rendez-vous quelque part – on apprendra plus tard où -, et qui bouscule, qui ne fait attention à rien. Lacan disait qu ‘avec le lapin pressé on prendra la mesure – je le cite – de l’absolue altérité du patient. Eh bien disons que c’est dans la psychanalyse que cette absolue altérité l’emporte, doit l’emporter pour qu’elle puisse être opérante, sur tous les sentiments de commisération, de compréhension et de communauté. C’est en quoi même contrôler la position analytique, comme un analyste a à le faire, seul ou en s’aidant d’un autre, c’est contrôler, c’est doser son inhumanité. Mais l’inhumanité , c’est un slogan dont il faut user avec modération, son inhumanité, c’est le respect de l’absolue altérité de l’autre. Si je prends au sérieux que Lacan quand je l’isolais dans cette posture se reconnaissait comme « parfaitement photographié », je dois dire que sa position foncière comporte que l’Autre, le grand Autre, dans la circonstance, l’ensemble de ceux qui font les spectateurs, l’Autre est bon et on peut dire corrélativement, en même temps qu’il assigne la bonté à l’Autre, qu’il lui assigne le sens commun, qu’il lui assigne la reconnaissance entre des semblables, nous partageons le même savoir, nous rions aux mêmes lapsus de l’Autre, à ses plaisanteries et on sent ainsi cet Autre, la masse de cet Autre à l’occasion parcourue d’ondes, vagues similaires. En regard lui Lacan, en regard de cette bonté de communauté, en regard lui, il est méchant. Et je le montre, au fond, blessant incessamment la sensibilité samaritaine d’une assistance pour une part, pour une grande part, faite de médecins et de psychologues. Lui, il assume d’être le méchant de l’affaire, il assume si je puis dire un « je suis méchant ». Et c’est en quoi non seulement sa position n’est pas paranoïaque mais elle est proprement une paranoïa inversée.
Mettons en regard le cas Jean-Jacques Rousseau. Lui, comme paradigme. Eh bien dans ce paradigme c’est l’Autre qui est méchant, c’est la civilisation qui est nocive et empreinte de méchanceté tandis qu’il revendique pour sa personne un fondamental « je suis bon », et qu’il l’étend, il étend cette déclaration à l’homme primitif. Tandis que Lacan, lui, il étend son « je suis méchant » à la position du sujet, je ne dirais pas de l’inconscient, mais à proprement parler il l’étend au sujet de la pulsion.
Cette inversion de la paranoïa, si on l’isole ainsi, permet de mettre en série nombre d’énoncés de Lacan avec lesquels il jouait à surprendre, scandaliser, émouvoir son auditoire. Par exemple, quand il lui arrive de dire « Je n’ai pas de bonnes intentions » et même « à la différence de tout le monde », il parade en être méchant. N’oublions pas que les bonnes intentions, on dit que l’enfer en est pavé, on n’a pas attendu Lacan pour s’en méfier de la bonne intention. La bonne intention s’établit sur la supposition que je connais ton bien. C’est en raison de cette supposition gratuite, hasardeuse, cette supposition qui nie l’absolue altérité, c’est en fonction de cette supposition que je peux imaginer que mon intention est bonne, et par-là déployer à l’endroit de cet Autre que je crois connaître comme ma poche, tous les ménagements voire m’offrir à me sacrifier ou du moins au moins à me contraindre. À cet égard, ne pas avoir de bonnes intentions est de l’ordre de la salubrité. Ça veut dire : je ne préjuge pas de ce qu’est ton bien. Et pour l’analyste, il faut bien dire que c’est de tous les instants qu’il a à se méfier de ses bonnes intentions puisqu’on vient lui demander son aide et qu’il est par fonction préposé à faire le bien de l’Autre, il est requis dans cette fonction. C’est le fruit d’une discipline que de ne pas s’autoriser de cette présomption pour commencer par s’abstenir du savoir du sens commun.
C’est d’autant plus essentiel quand ce qui est en question, c’est le choix d’objet du patient, quand l’affaire concerne le lien que le patient a noué avec un partenaire : mari, épouse, concubin, compagne, et qu’il vient s’en plaindre, ou même s’il ne s’en plaint pas que l’analyste est conduit comme invinciblement à désapprouver, à considérer que, de toute évidence, il y a là un lien nocif ou pathologique et que, d’une façon ou d’une autre, il s’emploierait à le dénouer, à l’aider à se dénouer. Or c’est là que s’impose le précepte « Tu ne jugeras point« où il importe que l’analyste ne fasse pas confiance à ses préjugés de sens commun, et que si deux se sont retrouvés il vaut mieux partir de l’idée qu’il y a un niveau où ces deux-là se conviennent. Là, c’est toujours dans ce registre que la bonne intention de l’analyste s’expose à des retours qui surprennent, que de voir que débarrassé du partenaire, le sujet se trouve réduit ou à l’errance ou à un malaise, un malheur encore plus intense.
Le bonheur pour un analyste, ça n’a rien à voir avec se sentir bien, être heureux. Il y a un niveau où le sujet est heureux et qui n’a rien à voir avec aucun bien-être. Le bonheur se trouve au niveau de la pulsion et au niveau d’une expérience dont on doit supposer qu’elle satisfait puisque tout est bon pour qu’elle se répète et rien n’implique que cette expérience s’éprouve comme bien-être. Le bonheur repose sur l’égoïsme de la pulsion, qui trouve sa satisfaction en elle-même sur le modèle d’une boucle. C’est ainsi que Lacan avait donné comme paradigme de la pulsion le propos de Freud sur la pulsion orale dont la satisfaction évoquait la bouche qui s’embrasse elle-même. La subversion freudienne du sujet conduit à poser la solitude du sujet au niveau de sa jouissance. Et cette solitude du sujet au niveau de sa jouissance est corrélative de sa méchanceté foncière. La pulsion n’est pas humaniste, si je puis dire.
Alors il faut quand même qu’avant de finir j’aie évoqué les souvenirs que je vous avançais au début.
Voilà le premier. Ça n’est pas dans la rue, Lacan est à sa table, travaille dans l’atelier, éclairé par une lampe, je le vois, le papier, sa tête, cheveux blancs, le reste de la vaste scène, le plafond aussi haut qu’ici même ; je suis là sur sa droite, je ne saurais plus dire ce que nous échangions avant, peut-être lui avais-je posé quelques questions sur un séminaire établi. Quelle ouverture y a-t-il eue pour que je puisse l’interroger – les termes précis ne sont pas restés dans ma mémoire -, pour que je puisse l’interroger sur sa structure clinique à lui. Comment lui ai-je demandé ça? Ça devait être dans un contexte où je n’ai eu qu’à dire : « Et vous dans tout ça ? »
Je crois que ça a été vraiment très bref et allusif et sa réponse l’a été aussi. Beaucoup de choses dans le geste, dans l’attitude, dans le suspens de la parole, mais il reste le mot essentiellement : « obsessionnel« . C’était enchâssé dans un contexte où il devait être question de » Il suffit de voir comment je réfléchis » , « il suffit de voir comment je m’y prends, il suffit de voir comment je répète », quelque chose de cet ordre et ça n’est pas parti du tac au tac, ça a été pris dans ce rythme lent qui donnait confiance dans le fait que la réponse était ajustée. Donc il m’a lâché ça. Exceptionnel.
Il faut bien dire que la pensée de Lacan a un certain aspect intra-subjectif. On y voit, quand elle s’exprime dans ses écrits, dans son séminaire semaine après semaine, le retour permanent du même. Des mêmes formules ciselées, considérées sous diverses faces, le retour des mêmes thèmes. Par exemple : le stade du miroir, le maître et l’esclave. Dans une certaine pauvreté du matériel conceptuel : le sujet, le grand Autre, l’objet petit a.
Il y a là une reprise incessante et continue qui oblige à beaucoup d’attention pour s’apercevoir quand la valeur des termes change. Et c’est même cette passion-là qui m’a engagé dans ces cours, depuis des décennies, à repérer chez l’Autre l’incessant bougé de ce charroi de quelques personnages conceptuels, si je puis dire. Et qui contraste avec la diversité même de la luxuriance des commentaires que Lacan apporte à ce matériel, quand il en bouge d’une façon presque insensible la disposition. C’est ce contraste là, moi, qui m’a happé, le foisonnement d’idées en surface, rapporté à de minuscules décalages de termes. Et une volonté chez Lacan, persistante, de reformuler, dans les termes de ce matériel conceptuel, tout ce qui advient. Pas du tout indifférent aux événements de pensées qui peuvent survenir ou à l’évolution du discours universel mais avec la volonté de ramener dans sa toile ce qui se produit, pour continuer de jouer avec les mêmes termes familiers, en arrivant à leur donner une valeur, une couleur, une tonalité, un dynamisme toujours renouvelé. Cette richesse se développe sur la base d’une grande pauvreté. On doit sans doute, enfin je suis porté à prendre au sérieux le témoignage qu’il a donné chez lui d’une contrainte à penser.
Il ne cache pas qu’il est sujet, dans son enseignement et dans sa poursuite année après année, à partir d’une certaine date, à un Wiederholungszwang, un Zwang qu’il lui est arrivé de rapporter à son surmoi – à l’opposé de Jean-Paul Sartre qui s’imaginait sans surmoi, qui s’en vantait (le concept qu’il avait du surmoi n’était pas des plus raffinés). Lacan, au contraire, a pu lâcher une ou deux fois dans son Séminaire qu’il subissait une contrainte à penser qu’il attribuait à ce surmoi qu’il avait baptisé, qu’il avait décoré des termes d’obscène et de féroce dans son enseignement.
On peut dire qu’au fur et à mesure qu’il entre dans son dernier enseignement, cette instance devient toujours plus pure, justement parce qu’il multiplie les témoignages de son malaise, de sa réticence, de son manque d’allant et d’envie de faire Séminaire. Il témoigne abondamment qu’il ne se sent pas bien et comme il est là, comme il continue, on est bien forcé de supposer que quelque part quelque chose en lui se satisfait et il ne peut pas faire autrement. Et cela toujours devant un auditoire qu’il éprouve comme largué, c’est-à-dire comme bête. Et, au fond, c’est ça, son Autre, son grand Autre, ce n’est pas un Autre méchant, c’est un Autre qui est bon, qui est bête et surtout qui est endormi. On peut dire que dans son Séminaire, si on avait à désigner le désir de l’Autre, le fameux désir de l’Autre, il faudrait dire : c’est le désir de ne pas être dérangé, Lacan se posant lui-même comme l’éveilleur, comme le seul qui assume son je suis méchant jusqu’au bout.
J’ai encore le temps, en allant vite, de vous dire le second souvenir.
Cette fois, c’est à table, rue d’Assas, en famille. J’arrive à lui demander : « Au fond pourquoi avez-vous fait médecine ? » C’était déjà la reprise d’une question que je lui avais posée un ou deux, ou deux ou trois ans après avoir fait sa connaissance. Je ne voyais vraiment pas, j’étais encore très absorbé par la philosophie, le choix de la médecine me paraissait absolument saugrenu pour Lacan, pour l’élévation de sa pensée, la quantité de son information. Donc j’avais dû lui demander sans doute à l’époque pourquoi il n’avait pas fait philosophie (rires), j’avais dû lui poser la question et il avait répondu quelque chose de l’ordre : « Oh ! Oui, j’aurais dû faire autre chose. » Mais cette fois là, rue d’Assas, des années plus tard, il me répondit quelque chose de cet ordre : qu’il y avait un seul dont il était absolument sûr, un médecin dont la parole, dans sa famille, à lui Lacan, faisait autorité. Voilà sa réponse. Le mot que je certifie c’est le mot « autorité ». Ce qu’il avait retenu, c’était l’autorité dont jouissait ce médecin. On doit supposer tout de même une expérience assez ancienne, familiale.
Il faut bien dire qu’à travers la psychanalyse, une parole qui fait autorité, Lacan a réussit à mettre ça au point – c’est le moins qu’on puisse dire.
En même temps, je crois devoir noter tout de même que ça n’a pas été sa première vocation.
Sa première vocation de jeune homme, au moins dont on ait le témoignage, ça a été de partir aux colonies. Ce qui est drôle, c’est qu’avant qu’on en ait eu le témoignage écrit, j’en avais comme le pressentiment. J’en avais le pressentiment à cause d’un passage du Séminaire sur Le transfert où il y a un petit couplet d’une dizaine de lignes de Lacan un peu saugrenu, qui vient comme un cheveu sur la soupe, et je m’étais toujours dit : « Oh là là, ça, ça n’est pas… » Et on en a eu le témoignage écrit quand on a publié des lettres à Charles Maurras, – Maurras oui – parmi lesquelles une lettre de Mme Léon Daudet recommandant le jeune Jaques Lacan à Charles Maurras, le présentant comme un fanfaron, un jeune fanfaron ne doutant de rien, qui n’est pas si difficile à imaginer, parce qu’on l’a vu fanfaron par la suite, sauf qu’il avait derrière lui de quoi fanfaronner ; c’est plus surprenant chez le garçon de 20 ans voulant rencontrer Maurras parce que voulant militer pour les idées de l’Action française – mais oui ! peut-être en parlerons-nous un peu plus tard -, mais surtout annonçant son départ aux colonies.
Et, là, il faut dire – je terminerai là-dessus – comment j’ai eu cette lettre. Tout est empreint là de pressentiments. Je passais devant une librairie, la librairie Delamain, place Colette, et je vois dans la devanture un livre qui s’appelle Lettres à Charles Maurras. Je dis à mon fils avec qui j’étais, allons voir ce livre, je suis sûr qu’on y parle de ton grand-père. Je regarde le livre, il y a en effet une lettre, la lettre de Mme Daudet, où on parle de Jacques Lacan. Et là, je me souviens de ce passage du Séminaire du Transfert qui m’avait paru quand même bien curieux à propos de la trilogie de Claudel, de la seconde pièce de Pain dur où il est question du fils, du fils de Turelure, Louis de Coûfontaine, celui à qui il faut 20 000 francs pour sauver ce qu’il a acquis en Algérie et à qui son père le refuse.
J’avais été frappé de la singulière tendresse avec laquelle Lacan parlait de ce gandin qui, vraiment, découpe une figure quelconque dans la pièce de Claudel. Lacan évoque cette terre « où il a engagé sa passion ». Dans la pièce, on n’y voit pas ce Louis de Coûfontaine comme un être de passion et – page 349, c’est là que vous trouverez ça -, Lacan brode là dessus :
« Car cette terre près d’Alger dont il s’agit, c’est là que Louis de Coûfontaine a été chercher le rejet – au sens de quelque chose qui a rejailli et qui rejette, au sens du rejeton – le rejet de son être, de sa solitude, de cette déréliction où il s’est toujours senti […]
C’est de la passion d’une terre, c’est du retour vers ce dont il se sent chassé, à savoir de tout recours à la nature, c’est de cela qu’il s’agit. Et à la vérité, il y a là un thème qui vaudrait bien que l’on considère dans la genèse historique de ce que l’on appelle le colonialisme, et qui est celui d’une émigration qui n’a pas seulement envahi des pays colonisés, mais qui a aussi ouvert des pays vierges. La ressource donnée à tous les enfants perdus de la culture chrétienne vaudrait bien qu’on l’isole comme un ressort éthique, que l’on aurait tort de négliger au moment où l’on en mesure les conséquences. »
J’ai lu ça bien avant de trouver la lettre. Un étrange éloge non pas du colonialisme mais tout de même… le cœur battant pour « les enfants perdus de la culture chrétienne » qui trouvaient là l’occasion d’une aventure leur permettant de rédimer leur solitude et leur déréliction. Il me semble que de ce sentiment de solitude, de cette déréliction dont Lacan fait un ressort éthique – et le mot « éthique » est toujours dans son vocabulaire, dans son altérité à lui valorisé positivement -, nous avons dans ce petit passage comme une allusion au jeune Lacan. Et là je dis que je suis aux limites, parce que c’est interpréter la vie de Lacan, que quant à ce qui est de rédimer la déréliction de son être, la psychiatrie est venue à la place de l’Algérie.
Voilà, à la semaine prochaine.
Applaudissements.